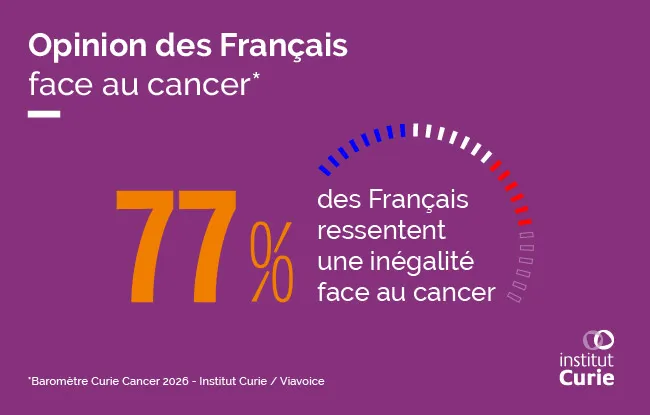- Accueil >
- Les actualités de l'Institut Curie >
- Méiose et réparation de l’ADN : les chercheurs décryptent l’activité d’un complexe moléculaire spécifique
Ils ont élucidé le rôle du complexe appelé Mlh1-Mlh3 dans la réparation des mésappariements d’ADN et, fait unique, dans l’une des étapes clefs du brassage génétique lors de la méiose dont les dysfonctionnements sont à l’origine de différents types de pathologies. Leur étude est publiée dans PNAS.
Durant la méiose, se produit un phénomène de recombinaison du matériel génétique entre les chromosomes homologues, qui contribue au brassage génétique. La recombinaison ne peut se faire que grâce à des mécanismes fins de cassures et de réparations ultérieures des molécules d’ADN. Ces mécanismes sont très conservés chez les eucaryotes, de la levure à l’Homme. Notamment, des « nœuds » (jonctions de Holliday) se forment entre les chromosomes homologues pour les faire s’enjamber en vue de leur recombinaison. Ces mécanismes de recombinaison sont essentiels pour assurer une ségrégation correcte des chromosomes dans les gamètes. Un échec de ces étapes entraîne la génération de gamètes avec un nombre anormal de chromosomes (trisomie, syndrome de Turner, stérilité).
Deux complexes moléculaires similaires et pourtant… différents !
Le complexe « Mlh1-Mlh3 » est un facteur de réparation des mésappariements d’ADN qui sont générés suite à des erreurs des polymérases réplicatives. Il possède une activité endonucléase, c’est-à-dire qu’il peut couper une molécule d’ADN entre deux briques (nucléotides) successives et non à ses extrémités. Contrairement à d’autres facteurs de réparation des mésappariements assez semblables, Mlh1-Mlh3 exerce aussi son activité endonucléase lors de la méiose, au niveau des jonctions de Holliday ; il est indispensable à l’enjambement de portions de chromosomes. Le complexe Mlh1-Pms1, qui est le facteur principal pour réparer les mésappariements d’ADN, n’est pas impliqué dans la méiose.
Pour autant, les deux complexes présentent de nombreuses similitudes structurales. Par exemple, ils se forment par l’interaction entre les domaines c-terminaux de Mlh1 et de son partenaire Mlh3 ou Pms1. Quelles sont les bases structurales à l’origine des différences de spécificité entre Mlh1-Mlh3 et Mlh1-Pms1 ? Des chercheurs du CEA-Joliot (département I2BC, Laboratoire de biologie structurale) et de l’équipe « Dynamique des chromosomes et recombinaison » dirigée par Valérie Borde à l’Institut Curie, avec l’aide du CEA-Jacob (département IRCM) et d’une équipe suisse, ont résolu par radiocristallographie la structure tridimensionnelle d’un complexe formé par les domaines d’interaction de Mlh1 et Mlh3 (à partir de protéines recombinantes purifiées) de la levure S. cerevisiae et l’ont caractérisée fonctionnellement. Ils l’ont comparée avec celle déjà connue du complexe équivalent formé entre Mlh1 et Pms1.
Leur étude, publiée dans PNAS, révèle des différences entre les deux complexes, concernant notamment le repliement des protéines, la surface d’interaction avec l’ADN, la formation de structures filamentaires et d’autres spécificités de reconnaissance de l’ADN.
Ces résultats sont l’aboutissement d’une collaboration fructueuse qui a démarré il y a déjà plusieurs années avec le CEA et nos collègues suisses. Nous sommes ravis d’avoir pu élucider la fonction intrigante de ce complexe moléculaire impliqué dans la réparation de l’ADN pendant la méiose, au moment où se produit une vague de recombinaison chromosomique. C’est une brique de plus pour comprendre des mécanismes à l’origine de pathologies telles que certaines formes de cancers héréditaires.
Déclare Valérie Borde, chercheuse CNRS, cheffe d’équipe à l’Institut Curie
Cette première comparaison au niveau structural des complexes Mlh1-Mlh3 et Mlh1-Pms1 suggère fortement une spécialisation au cours de l’évolution de chacun d’entre eux. Ces travaux ouvrent des perspectives pour mieux comprendre certaines pathologies liées à des mutations au niveau de ces complexes et des processus de réparation des erreurs réplicatives et de recombinaison méiotique. Pour aller plus loin, il faudra obtenir des structures par cryo-microscopie électronique des deux protéines entières, en interactions avec leur substrat ADN.

Références :
J. Dai, A. Sanchez, C. Adam, L. Ranjha, G. Reginato, P. Chervy, C. Tellier-Lebegue, J. Andreani, R. Guérois, V. Ropars, M-H Le Du, L. Maloisel, E. Martini, P. Legrand, A. Thureau, P. Cejka, V. Borde, J-B Charbonnier. Molecular basis of the dual role of the Mlh1-Mlh3 endonuclease in MMR and crossover formation in meiosis | PNAS, 2021 June 8 118(23) doi: 10.1073/pnas.2022704118
Source : CEA (Institut des sciences du vivant Frédéric Joliot)