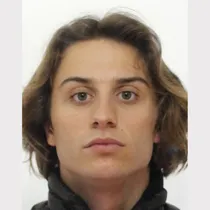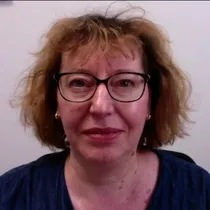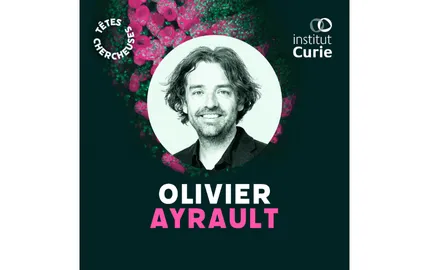Présentation

Depuis le 1er Janvier 2025, le groupe d’Olivier Delattre (Diversité et plasticité des sarcomes pédiatriques) est accueillie au sein de l’équipe d’Olivier Ayrault.
Introduction
Les mécanismes spécifiques au développement d’un organe et à la formation de tumeurs liés à ce même organe sont étroitement associés. Pour étudier les événements qui interviennent au cours du développement normal et qui sont liés aux cellules tumorales, nous avons décidé de nous concentrer sur (i) le développement du cervelet et (ii) le médulloblastome (MB) ; solide tumeur du cerveau, comme modèles d’étude. Le cervelet est une structure laminaire qui assure la médiation d'importantes fonctions sensorimotrices et cognitives telles que la pensée, le raisonnement et la mémoire. Les dérégulations de ces processus de développement ainsi que certaines altérations génétiques contribuent ensemble à l’initiation et à la progression du médulloblastome. Le médulloblastome est la tumeur embryonnaire agressive la plus fréquente du cervelet, causant un degré élevé de morbidité et de mortalité pédiatriques. À ce jour, près d'un tiers des patients meurent du médulloblastome cependant les conséquences des thérapies sur les patients tels que les déficits cognitifs et les séquelles neuropsychologiques font du développement de nouvelles thérapies ciblées une priorité.
Classification des MBs :
Le consensus international reconnaît quatre sous-groupes de médulloblastomes distincts avec des caractéristiques moléculaires, des pronostics et des taux de mortalité divergents chez les patients. Le sous-groupe 1 est caractérisé par une activation de la voie Wingless (WNT). Le sous-groupe WNT a le meilleur pronostic, avec une survie globale d'environ 95-100%. Le sous-groupe 2 est associé à une forte activation de la signalisation Sonic Hedgehog (SHH). Les patients atteints de SHH MB ont un pronostic intermédiaire, avec une survie globale à 5 ans d'environ 75 % lorsqu'ils sont traités avec des thérapies conventionnels. L'étiologie des deux sous-groupes restants reste encore mal définie, comme le sous-entend leurs noms génériques Groupe 3 (G3) et Groupe 4 (G4). Ces deux groupes représentent plus de la moitié des patients atteint de MB; G3 a le plus mauvais pronostic de tous les MBs tandis que G4 est le sous-groupe le plus répandu bien qu'il soit le moins caractérisé aujourd'hui. Récemment, la communauté internationale a reconnu une subdivision des 4 sous-groupes en plusieurs sous-types mettant en évidence une réalité plus complexe de la biologie des MBs.
Objectifs:
Malgré des avancées majeures, la biologie en lien à la genèse du médulloblastome reste à affiner et des questions cruciales dans le domaine sont encore à élucider :
(i) De quel type cellulaire provient chacun des sous-groupes de médulloblastome ?
(ii) Quels sont les principaux événements moléculaires et cellulaires contrôlant chaque sous-type de médulloblastome ?
(iii) Quel sont les thérapies d’avenir ciblées à développer pour chacun des sous-groupes ?
L'objectif général de notre équipe est donc de décrypter les mécanismes fondamentaux liés à la biologie complexe du médulloblastome. Les voies de signalisation dérégulées dans le cancer du cerveau étant également à la base du développement normal du cervelet, nous axons nos études dans les contextes du développement normal et du cancer. À cet égard, nous avons mis en œuvre une approche interdisciplinaire innovante et développé de nouveaux outils à l'interface de la neurobiologie du développement et de la biologie du cancer.
Nos principaux objectifs sont les suivants :
- Identifier les acteurs clés et les mécanismes associés au développement normal du cervelet et au MB grâce à l'utilisation de technologies de pointe.
- Obtenir une vision globale de la biologie du médulloblastome à l'aide d'une analyse multiomique sur une large cohorte de patients.
Découvertes principales de l'équipe :
- Nous avons caractérisé comment le facteur de transcription Atoh1, essentiel au cours du développement normal du cervelet et à la formation du MB, était régulé à la fois dans les contextes normal et pathologique (Forget*, Bihannic* et al., Dev Cell, 2014 et Cigna et al., en préparation).
- Nous avons découvert de nouvelles fonctions pour la protéine Atoh1 grâce à l’utilisation de nouvelles technologie de pointe. Nos données révèlent un nouveau mécanisme par lequel Atoh1 module les fonctions du cil primaire afin de réguler la formation du cervelet ainsi que du MB (Chang*, Zanini*, Shirvani* et al., Dev Cell, 2019).
- Nous avons développé une analyse multiomique de tous les sous-groupes de MB intégrant des données phosphoprotéomiques (Forget et al., Cancer Cell, 2018). Grâce à cette étude: (i) l'analyse protéomique met en évidence une activation de la voie des récepteurs à Tyrosine Kinase ainsi que la protéine SRC phosphorylé spécifiquement dans le groupe 4. (ii) l'analyse multi-omique intégrative révèle que la signature à l’échelle transcriptomique ne reflète pas entièrement les profils d'expression des protéines dans les groupes 3 et 4.