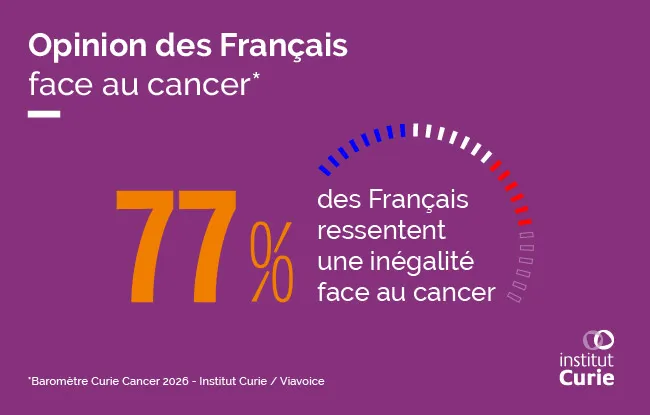- Accueil >
- Les actualités de l'Institut Curie >
- Intelligence Artificielle, ressources humaines : des enjeux prioritaires au cœur des Rencontres hospitalières des partenaires de l’Institut Curie
Le 4 juillet 2025, l’Institut Curie a organisé deux tables-rondes avec le concours – et au bénéfice – des directions générales et de médecins de plus de 20 établissements hospitaliers franciliens. Au programme de cette rencontre, deux thèmes majeurs qui appellent réflexions communes, expérimentations de terrain et stratégies ambitieuses : l’intégration de l’intelligence artificielle dans les outils, pratiques et processus hospitaliers, et le rôle de la ligne managériale dans la capacité des établissements à attirer et fidéliser les professionnels de santé.
Les nouveaux challenges en radiothérapie
Entre 2020 et 2040, les besoins en radiothérapie devraient augmenter de 32 % dans les pays industrialisés. Si le plateau technique de l’Institut Curie figure parmi les plus complets d’Europe, ces projections, rappelées par le Pr Gilles Créhange, chef de département Oncologie radiothérapie de l’Ensemble hospitalier de l’Institut Curie, confirment la nécessité permanente d’innover : à la fois en termes de prise charge, avec des traitements toujours plus précis dans la délivrance de la dose et la protection des tissus sains (radiothérapie adaptative, radiothérapie FLASH), et d’appui sur des plateaux techniques de pointe.
C’est l’orientation privilégiée par l’Institut Curie. Grâce à un plan pluriannuel d’investissements de 56 M€, « les équipes disposeront d’ici 2028 d’un parc composé uniquement de machines dédiées, capables de faire de la stéréotaxie ou de l’IMRT, sur des volumes conséquents de patients », précise Gilles Créhange. La stratégie repose notamment sur des paires de machines en miroir sur les sites et entre les sites, pour garantir la continuité des soins.
L’intervention de Gilles Créhange a aussi mis l’accent sur une problématique majeure : le manque récurrent de manipulateurs. « Les jeunes professionnels, en sortie d’école, mettent en avant des barrières psychologiques face à un métier aux fortes responsabilités, indique Gilles Créhange. Nous travaillons donc avec la direction générale et la direction des Ressources humaines pour proposer des parcours professionnels plus attractifs. » L’avenir de la radiothérapie, esquissé par l’expert, dépendra également du recours à l’IA « à toutes les étapes du traitement et du suivi, pour faciliter le travail des équipes ».
Table ronde 1 - Stratégie IA : comment accompagner le changement d’outils au sein d’une communauté médicale ?
Dans le domaine de la prise en charge, l’intelligence artificielle va entraîner de profonds bouleversements, comme l’a rappelé le Pr. Steven Le Gouill, directeur de l’Ensemble hospitalier de l’Institut Curie et modérateur de la table-ronde. Accessibilité et stratégie nationale, organisation et gouvernance, défis prospectifs (ROI, environnement, formation)… Les chantiers qui s’ouvrent s’annoncent majeurs.
L’arrivée massive de la data dans tous les domaines du soin, ainsi que le développement d’outils d’IA basés sur la donnée, représentent des opportunités pour gagner en efficacité. Encore faut-il identifier celles qui se révèlent les plus prometteuses. Le Pr. Pierre Vera, directeur général du Centre Henri-Becquerel, a réalisé un voyage d’observation aux États-Unis pour découvrir les tendances à l’œuvre dans des établissements de premier plan, comme le centre médical Cedars-Sinaï en Californie. Parmi les avancées les plus intéressantes : un pilotage en temps réel, appuyé sur des tableaux de bord de plus en plus sophistiqués (par exemple, taux de remplissage des soins, suivi du parcours patient…) ; l’identification des patients complexes et l’amélioration de la prédiction des risques ; l’arrivée des « foundation models » (modèles de fondation), capables de traiter des formats variables de données – textes, images, voix…
Pierre Vera retient en particulier deux axes majeurs de développement de l’IA : « L’amélioration de la gestion du parcours patient, et le développement d’applications pour aider les soignants et les administratifs ». Des défis technologiques restent à relever, comme la capacité de pilotage par la data (entrepôts de données de santé, dossiers informatisés…), ou le niveau d’interopérabilité et de standardisation des données. « L’IA ouvre la voie aux projets médico-scientifiques avec une dimension IT », estime Pierre Vera.
Champs d’application et conditions de déploiement de l’IA en cancérologie
La cancérologie est un domaine prometteur de l’IA à plusieurs niveaux, comme l’a rappelé Nicolas Scotté, directeur général de l’INCa : expérience patient et relation avec le corps médical, (« par exemple l’adaptation des messages pour les personnes vulnérables ») ; imagerie (« sur le dépistage organisé, comment simplifier le système de lecture et limiter le taux d’erreurs en deuxième lecture ») ; anatomopathologie (« pour des gains de temps, notamment sur l’analyse histologique ») ; interception des cancers, « avec la définition de modèles prédictifs », etc.
Si les champs d’application de l’IA sont nombreux, les conditions de son déploiement interrogent les établissements. Le retour d’expérience de l’Hôpital Foch, apporté par son directeur de l’Innovation, Alexandre Drezet, porte sur une vingtaine d’applications mises en place depuis un an : « Nous avons structuré un comité IA transdisciplinaire qui opère une veille technologique, valide les partenaires sélectionnés et les cas d’usage, puis recueille les feedbacks des utilisateurs – administratifs, soignants... » Plusieurs leviers sont à privilégier : « partir du terrain, des besoins métiers ; s’assurer du niveau de bande passante technique ; et s’appuyer sur des early adopters, qui vont être des ambassadeurs de la dynamique ».
Une logique de test & learn, avec comme cadre une gouvernance
Pour Guillaume Chesnel, directeur général du Groupe hospitalier Diaconesses-Croix-Saint-Simon, l’IA pose de nombreuses questions de gouvernance : « Elle doit être solide, éthique et partagée ». La technologie, « qui interroge l’organisation, les responsabilités, la culture professionnelle », doit s’intégrer aux enjeux de cœur de métier : le consentement éclairé du patient, la consolidation et la sécurisation des données, la responsabilité médicale, la prévention des biais, etc. « Nous devons aussi décider comment nous situer face à l’IA : être modéré, aller tous azimuts pour disposer de preuves de concepts, prendre en compte les irritants… ».
Les échanges ont notamment porté sur la création de valeur apportée par l’IA. Comme l’a rappelé le Dr Ayden Tajahmady, directeur de la Stratégie et de la transformation de l’AP-HP, « il est essentiel de raisonner en logique de cas d’usage. L’IA appelle des enjeux importants d’investissements, de structuration SI, de formation, de changement de culture et de processus… Or elle a de la valeur dans un contexte donné, dans une organisation spécifique. » La démarche pertinente, à ses yeux, consiste à tester et à évaluer l’impact réel, en situation, avant d’envisager un déploiement à plus large échelle. « Les enjeux portent aussi sur l’adaptation des procédures médicales à l’utilisation de l’IA. »
L’expérimentation dans le déploiement de dispositifs d’IA, avec pour fil rouge la notion de plus-value et d’efficience, ressort comme un élément commun aux intervenants. Ils soulignent, également, le besoin d’une gouvernance dédiée au sein de chaque établissement.
Table ronde 2- Attractivité et fidélisation des professionnels de santé : quelles stratégies managériales ?
Les établissements hospitaliers sont confrontés à une « crise des ressources humaines » qui impacte directement la qualité de vie des équipes, a rappelé Anne-Claire de Reboul, directrice adjointe de l’Ensemble hospitalier de l’Institut Curie, et animatrice de la table-ronde. Un constat qui implique de comprendre les aspirations des professionnels, notamment la jeune génération, pour identifier les réponses pertinentes.
Dans le cadre des travaux de sa Démarche Prospective « Horizon 2030 », Unicancer a réalisé une enquête auprès des professionnels des centres de lutte contre le cancer pour définir des actions RH prioritaires en phase avec leurs attentes. Plusieurs éléments contribuent à attirer et fidéliser, en particulier la manière dont est organisé et gouverné un CLCC : direction médico-administrative, expertise 100% cancérologie, polyvalence des activités, travail collaboratif, prise en charge centrée sur le patient, management participatif… « Ce sont des facteurs importants, tout comme l’humanisme, la solidarité, le climat de confiance et de bienveillance qui sont des valeurs reconnues et auxquelles les personnels sont très attachés », précise Nicole Bouwyn, Directrice des Ressources humaines du Groupe d’Unicancer. D’autres aspects de l’expérience collaborateur comptent particulièrement : respect de l’équilibre vie professionnelle vie personnelle, revalorisations salariales, formation et évolution des parcours professionnels, carrières dynamiques orientées vers la progression et l’amélioration des compétences et/ou de l’expertise.
Des retours du terrain dans lesquels se retrouve le Dr. Nicolas Pouget, chef de service Sénologie et gynécologie de l’Institut Curie : « Les valeurs et comportements d’équipe, comme les décisions collégiales, sont mis en pratique au quotidien. À défaut de leviers salariaux conséquents, nous faisons en sorte de proposer des conditions confortables de prise en charge, avec des locaux et des équipes support de qualité, des opportunités de formation, du temps dédié à la recherche. La jeune génération exprime sa volonté de “bien” travailler. »
La conduite du changement, un défi managérial
La rôle du manager – cadre, chef de service – est crucial dans cette dynamique, en particulier dans les contextes de conduite du changement. En 2024, le Groupe hospitalier Nord-Essonne a rassemblé les activités de trois sites dans un nouvel hôpital implanté sur le plateau de Saclay. L’enjeu de son directeur général, Cédric Lussiez, et de ses équipes : « Éviter les pertes en capacités RH, liées notamment aux temps de trajet supplémentaire ». Plusieurs leviers ont été actionnés : diminution des ratios patients, généralisation du rythme en 12h, augmentations des rémunérations, crèche et places de parking…
« 97 % des personnels ont rejoint le plateau de Saclay, aucun lit n’a été fermé. Mais pas de triomphalisme : ces mesures ont eu un impact financier important, et des problématiques RH persistent chez certaines équipes, notamment sur le volet managérial. » Des changements globaux n’effacent pas toutes les problématiques de terrain, estime ainsi Cédric Lussiez : « Il faut être attentif à la bonne allocation de ressources sur l’encadrement, donner plus de temps et de missions à valeur ajoutée, pour favoriser la qualité du duo cadre-chef de service ».
Des programmes et formations dédiés
Dans un contexte de désaffection pour les responsabilités managériales, qui touche tous les secteurs d’activité, l’appui à la prise de fonction revêt une importance majeure. À l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, la démarche prend plusieurs formes : programme de formation managériale à l’ESSEC, mentorat, féminisation des postes, mise en place d’un communauté managériale pour partager les expériences…. « Nous avons voulu aller plus loin sur les leviers d’engagement en coconstruisant un référentiel des valeurs de l’établissement, ajoute Julien Gottsmann, directeur général de l’hôpital. Il est articulé autour de principes d’action que l’on va tester pour le recrutement et pour l’évaluation. »
Dans la même logique, l’Institut Curie a lancé il y a un an son parcours manager, pour les médecins et les professionnels paramédicaux : tests de connaissance de soi, modules de mise en pratique… « Entre les modules, des sessions de co-développement et une plateforme d’e-learning leur sont proposés, précise Véronique Baudin, directeur des Ressources humaines de l’Ensemble hospitalier de l’Institut Curie. La moitié des managers ont déjà suivi le parcours, une centaine reste à former au cours des deux prochaines années. »
Les interventions ont permis d’identifier plusieurs pistes à privilégier : favoriser la qualité du binôme managérial, par un fonctionnement conjoint, un projet de service partagé, des formations communes de management, et du temps accordé à l’exercice managérial ; prendre en compte les attentes des équipes, favoriser la co-construction, les marges de manœuvre et l’initiative ; et privilégier la confiance, en donnant de la liberté et de moyens aux unités pour définir et s’approprier leurs règles de fonctionnement.