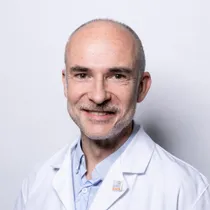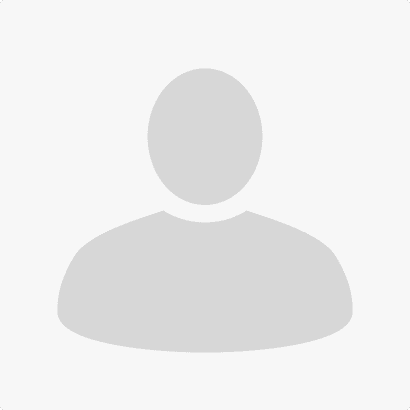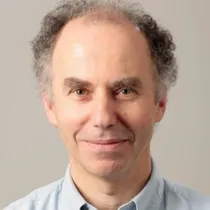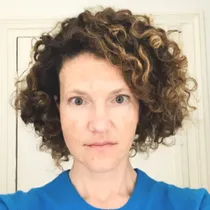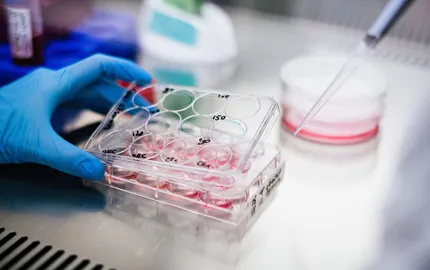Présentation
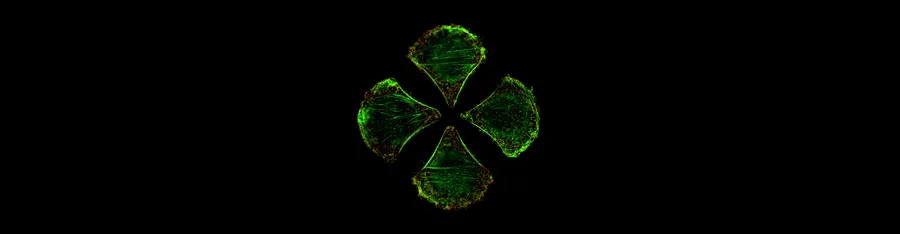
Les objectifs de notre équipe sont d’identifier des gènes potentiellement impliqués dans la progression tumorale des carcinomes, de valider leurs propriétés fonctionnelles in vitro et in vivo, d’étudier les mécanismes génétiques et épigénétiques responsables de leur activation ou de leur inactivation et de caractériser les voies de signalisation qui leur sont associés.
Pour identifier des gènes candidats, nous utilisons deux stratégies : une approche ciblant des groupes de protéines pouvant jouer un rôle dans la progression tumorale et une approche faisant appel à la biologie à grande échelle (exploitation des données du transcriptome et du génome obtenues par la technique des puces à ADN).
Approche ciblée
Nous avons centré notre travail sur les récepteurs à activité tyrosine kinase. En effet, d’une part ces récepteurs sont souvent impliqués dans la progression tumorale, d’autre part plusieurs exemples montrent que ce sont des cibles thérapeutiques particulièrement intéressantes (ERBB2 dans les cancers du sein, KIT dans les tumeurs gastro-intestinales stromales, FLT3 dans les leucémies lymphoblastiques aigues, EGFR dans les cancers du poumon à petites cellules et dans les cancers du côlon).
Approche à grande échelle
L’exploitation optimale des données du transcriptome et du génome et leur intégration aux données anatomocliniques et aux données biologiques requièrent des outils nouveaux.
En collaboration avec la plate-forme de Bioinformatique, le département de Biostatistique et l’équipe Bioinformatique du LIPN (Université Paris 13), nous développons de nouveaux outils permettant :
- d’identifier efficacement les gènes différentiellement exprimés entre deux groupes d’échantillons, en prenant en compte l’hétérogénéité tumorale,
- de rechercher les facteurs de transcription responsables des dérégulations d’expression observées dans les cancers,
- d’identifier des règles d’association entre des paramètres moléculaires (mutations, méthylation de l’ADN, etc.), cliniques (délais de récidives, etc.) ou anatomocliniques et les données du transcriptome et du génome,
- de pouvoir intégrer dans l’étude du transcriptome et du génome des tumeurs la connaissance toujours croissante des voies de signalisation
Choix des cancers étudiés
Nous avons choisi d’étudier les carcinomes de vessie pour plusieurs raisons :
- ce cancer pose un problème médical important. Il s’agit d’un cancer fréquent (quatrième cancer chez l’homme, septième chez la femme) qui récidive fréquemment après traitement,
- le carcinome de vessie est bien adapté aux études du transcriptome et du génome car les échantillons tumoraux sont assez homogènes et riches en cellules cancéreuses évitant des étapes de microdissection. De plus l’obtention de tissu normal pur (l’urothélium) sans stroma sous-jacent est possible, permettant des comparaisons aisées entre cellules normales et cellules transformées,
- l’étude que nous avons entreprise sur les carcinomes de vessie, initiée par le Pr. Dominique Chopin, bénéficie de collaborations étroites avec plusieurs services d’Urologie et d’Anatomopathologie de l’hôpital Henri Mondor à Créteil (coordinateur Dr. Yves Allory) et de l’hôpital Foch à Paris (coordinateur Pr. Thierry Lebret),
- une grande proportion des carcinomes vésicaux humains est due à des carcinogènes. L’existence de modèles murins chimio-induits permet d’analyser in vivo l’implication des gènes candidats dans la progression tumorale.
Les méthodes mises en place pour l’analyse des carcinomes de vessie sont ensuite appliquées à deux cancers traités et étudiés à l’Institut Curie : les carcinomes du sein (collaboration avec le groupe thématique sein de l’Institut Curie) et du col de l’utérus (collaboration avec le département de biologie des tumeurs).
Applications cliniques
Le point de départ de notre travail de recherche est basé sur l’étude des altérations moléculaires des tumeurs humaines. Bien que notre but premier soit la recherche fondamentale (faire progresser la connaissance des différentes étapes de la progression tumorale), il est clair que les résultats de nos travaux peuvent avoir des applications dans le domaine du cancer aussi bien pour le diagnostic, le pronostic que pour la thérapie. Par exemple la découverte que nous avons faite du taux élevé de mutations de FGFR3 dans les tumeurs de vessie a de nombreuses applications qui sont en cours d’évaluation. Grâce à une étroite collaboration avec les cliniciens et les anatomopathologistes, nous pouvons rapidement vérifier nos hypothèses de travail par des méthodes immunohistochimiques, d’hybridation in situ ou de FISH sur un grand nombre d’échantillons. Ce travail collaboratif permet le transfert des résultats issus de la recherche fondamentale vers la clinique et permet également de poser de nouvelles problématiques de recherche fondamentale.
Dans le cadre du programme CIT, financé et développé par La ligue contre le cancer, nous cherchons à déterminer les paramètres d’agressivité des tumeurs superficielles de haut grade (TaG3 et T1G3) et des tumeurs invasives T2. Après avoir trouvé une signature d’agressivité des tumeurs combinant les données du transcriptome et des altérations génomiques de 200 tumeurs de vessie, cette signature est validée par des méthodes immunohistochimiques et de FISH sur des TMA (« tissue microarrays ») contenant 500 tumeurs pour lesquelles les données cliniques seront disponibles (ce projet implique l’hôpital Henri Mondor, l’hôpital Foch, l’Institut Gustave Roussy, le LIPN, l’équipe CIT3 de La Ligue et l’Institut Curie).
Projets en cours
Nous avons mis en évidence plusieurs nouveaux gènes impliqués dans les cancers de vessie et du sein et codant pour des protéines qui sont des cibles thérapeutiques potentielles (comme la phosphatase PPAPDC1B). La caractérisation de ces gènes et des voies de signalisation associées est en cours.
L’étude combinée du transcriptome et du génome nous a permis d’identifier un nouveau mécanisme épigénétique dans les cancers. Jusqu’à très récemment, l’inactivation de gènes suppresseurs de tumeurs était vu comme un évènement focal, qui conduisait à l’extinction de gènes isolés. Nous avons montré que des régions chromosomiques entières pouvaient être inactivées par des mécanismes épigénétiques. Nous caractérisons pour chacune des régions, les mécanismes épigénétiques responsables de l’inactivation, et les gènes suppresseurs de tumeurs qu’elles contiennent.