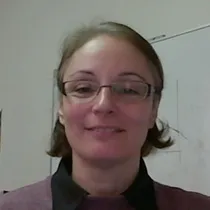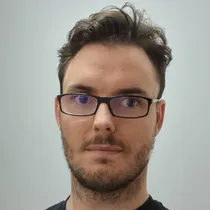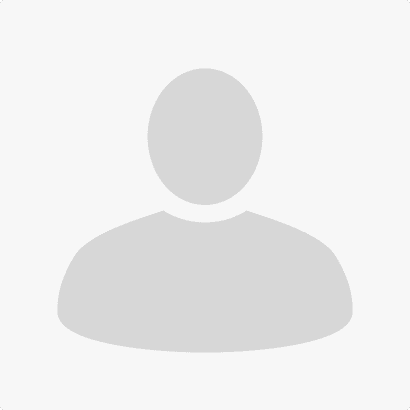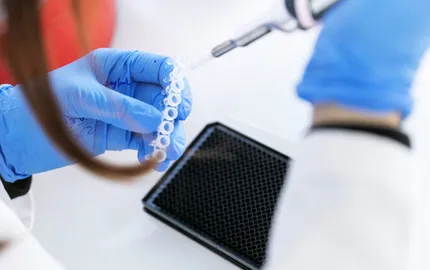Présentation

L’objectif principal de l’équipe est la reconnaissance des protéines par de petites molécules et son impact sur leur fonction biologique. Ainsi, les petites molécules peuvent être soit des sondes chimiques pour étudier les fonctions des protéines, soit des candidats médicaments. La découverte de nouvelles molécules interagissant avec le vivant bénéficie de l’expertise en chimie de synthèse et en modélisation moléculaire de l’équipe. Notre équipe de recherche est structurée autour de quatre activités principales : a) sondes moléculaires à 1-2 photons avec des propriétés fluorogéniques pour des approches d’imagerie cellulaire et de théranostique ; b) drogues activables par rayonnement ; c) programmes de découverte de drogues ; d) modélisation moléculaire. Notre équipe intègre des approches en chimie théorique, chimie de synthèse, biophysique, chémobiologie, chimie médicinale et biologie pour faire avancer les projets.
a) Sondes fluorogéniques à absorption mono et bi-photonique pour des applications en imagerie cellulaire, « click-and-release » et chirurgie guidée par la fluorescence.
Florence Mahuteau-Betzer (PI), Kévin Renault (CR), Delphine Naud-Martin (IE), Marie Schonau (AI), Malo Gourvest (PhD), Bryan Boulenger (PhD), Juichi Bainvel-Sato (PhD), Jenny Ha (Post-doc)
La microscopie à fluorescence permet de suivre les phénomènes dynamiques dans les systèmes vivants. Malgré les développements importants et récents de fluorophores organiques pour l’imagerie en cellules vivantes, il reste des défis à relever dans ce domaine. Le fluorophore idéal doit notamment absorber et émettre à des longueurs d’onde compatibles avec l’imagerie cellulaire. L’excitation biphotonique est de fait très attractive car elle utilise des longueurs d’onde d’excitation situées dans le proche infra-rouge (800-1000 nm), plage de plus grande transparence des tissus biologiques. De plus, elle permet une résolution spatiale élevée. Nous développons ainsi des fluorophores excitables à deux photons (section efficace d’absorption > 1000 GM) et les utilisons pour le développement de sondes fluorogéniques compatibles avec la chimie « click » pour les applications d'imagerie cellulaire et « click-and-release » pour des approches théranostiques. Enfin, ces fluorophores 2PA, ainsi que les fluorophores 1PA émettant dans le proche infrarouge, seront chimiquement modifiés pour leur conférer un caractère OFF-ON pour la détection et le traitement du cancer par chirurgie guidée par fluorescence.
- Silafluorene as a promising core for cell-permeant, highly bright and two-photon excitable fluorescent probes for live-cell imaging Auvray, M., Bolze, F., Clavier, G., Mahuteau-Betzer, F*. Dyes Pigm.2021, 109083.
- On the road for more efficient biocompatible two-photon excitable fluorophores Auvray,M., Bolze, F., Naud-Martin, D., Poulain, M., Bossuat,M., Clavier, G., Mahuteau-Betzer, F.* Chem. Eur. J. 2022, 28, e202104378.
- Ultrabright two-photon excitable red-emissive fluorogenic probes for fast and wash-free bioorthogonal labeling in live cells Auvray,M., Naud-Martin, D., Fontaine, G., Bolze, F., Clavier, G., Mahuteau-Betzer, F.* Chem. Sci. 2023, 14, 8119-8128.
b) Drogues activables par rayonnement.
Guillaume Bort (PI), Jonathan Ribes (PDoc), Lucie Marpaux (PhD), Marius Bichot (PhD), Mélanie Reis (PhD), Baptiste Lemonnier (gap year), Joséphine Ramé (gap year).
La capacité de contrôler l'action d'une thérapie dans l'espace et le temps in vivo a suscité beaucoup d'espoir au cours des dernières décennies, en raison de l'impact réel sur la sécurité et l'efficacité des traitements qui en résulterait, aboutissant à un meilleur index thérapeutique pour les patients. De nombreuses pathologies pourraient en bénéficier, notamment lorsque des effets secondaires graves sont présents en raison d'activités hors cible, comme dans le cas du cancer. La lumière est probablement le stimulus externe le plus couramment utilisé pour contrôler l’activation de molécules et donc des actions thérapeutiques associées1. Malheureusement, malgré des recherches intensives, très peu de traitements bénéficiant de cette technologie sont disponibles en clinique. La principale limite est que l'activation de ces composés photoactifs nécessite des lumières qui ne pénètrent pas profondément dans les tissus (< 2 cm)2.
Notre groupe conçoit des composés pouvant être activés à n'importe quelle profondeur dans le corps grâce à des stimuli basés sur des radiations telles que celles utilisées en radiothérapie, afin de contrôler des effets pharmacologiques spécifiques et sélectifs in vivo sans aucune restriction dans l'espace et le temps. Par cette approche, nous avons décrit des prodrogues théranostiques, radioswitches, détectables par IRM et activées par radiothérapie pour induire la mort de cellules cancéreuses3.
- 1 Visible-light-mediated modification and manipulation of biomacromolecules Lechner, V. M., Nappi, M., Deneny, P. J., Folliet, S., Chu, J. C. K., Gaunt, M. J. Chem. Rev. 2022, 122, 1752–1829.
- 2 Taking phototherapeutics from concept to clinical launch Vickerman, B. M., Zywot, E. M., Tarrant, T. K., Lawrence, D. S. Nat. Rev. Chem. 2021 6, 1–19.
- 3 Breaking photoswitch activation depth limit using ionising radiation stimuli adapted to clinical application Guesdon-Vennerie, A., Couvreur, P., Ali, F., Pouzoulet, F., Roulin, C., Martínez-Rovira, I., Bernadat, G., Legrand, F.-X., Bourgaux, C., Mazars, C. L., Marco, S., Trépout, S., Mura, S., Mériaux, S., Bort, G.* Nat. Commun. 2022, 13, 4102.
c) Programmes de drug discovery.
Florence Mahuteau-Betzer (PI), Claire Beauvineau (IR), Valérie Petit (IR), Véronique Delmas (DR), Lionel Larue (DRCE émérite), Liliane Mouawad (CRHC), Amine Bouidder (PhD).
L'environnement scientifique de l'Institut Curie est idéal pour le développement de programmes sur des cibles innovantes en oncologie. La chimiothèque Institut Curie-CNRS (hébergée dans notre unité) est un atout pour initier des projets collaboratifs avec des biologistes. Notre collaboration de longue date avec Abivax (2009-2022) nous apporte une expertise sur les programmes de découverte de médicaments, de l'optimisation des têtes de série à l'identification de cibles à l'aide d'outils moléculaires chimiques (Obefazimod dans les essais cliniques contre la RCH). Nous gérons des programmes de chimie médicinale et d'identification de cibles en collaboration avec différentes équipes : Mounira Amor-Guéret (IC), Lionel Larue (IC), Simon Fillatreau (INEM), Anna Castro (CRBM).
- Cytidine deaminase deficiency in tumor cells is associated with sensitivity to a naphthol derivative and a decrease in oncometabolite levels Mameri, H., Buhagiar-Labarchède, G., Fontaine, G., Corcelle, C., Barette, C., Onclercq-Delic, R., Beauvineau,C., Mahuteau‑Betzer, F.*, Amor-Guéret, M.* Cell Mol Life Sci 2022, 79:465
- The E-cadherin-ESR1-GRPR axis defines a sex-specific metastatic pathway in melanoma Raymond, J H., Pouteaux, M., Petit, V., Aktary, Z., Luciani, F., Wehbe, M., Gizzi, P., Bourban, C., Martianov, I., Davidson, I, Tomasetto, C.L., Mahuteau-Betzer, F., Vergier, B., Larue, L.*, Delmas V.* bioRxiv 2022
- Compounds inducing production of proteins by immune cells Fillatreau, S., Manfroi, B., Mahuteau-Betzer, F., Beauvineau, C., Dang, V D. WO2023 203161
- Compounds inducing production of proteins by immune cells Fillatreau, S., Mahuteau-Betzer, F., Beauvineau, C., Borzakian, S. WO2023 203162 & WO2023 203162
d) Modélisation moléculaire.
Liliane Mouawad (CRHC)
Nous utilisons plusieurs approches de modélisation pour étudier la dynamique des protéines, comme Serca1a (film 1, ref1) et le doublet de microtubules flagellaires (film 2, ref2), ou des chaînes d'acides nucléiques, comme le G-quadruplex (G4) (film 3), pour comprendre leur mécanisme. Nous effectuons également le criblage virtuel et l'amarrage de petites molécules dans des campagnes de conception de médicaments, comme pour les protéines kinase TAM (Tyro3, Axl et Mer) (ref3) ou les G4s (ref4). Nous nous concentrons actuellement sur les G4, qui sont des structures non canoniques d’ADN ou d’ARN qui constituent de bonnes cibles pour la recherche de traitements anticancéreux. Bien que petites, ces structures sont encore difficiles à classer, et celles récemment résolues montrent que leur repliement pourrait être bien plus complexe qu'on ne le pensait auparavant. Pour surmonter cette difficulté, nous avons créé le site ASC-G4 (http://tiny.cc/ASC-G4) pour calculer toutes les Caractéristiques Structurales Avancées des G4 (ref5). Ce travail nous a permis de clarifier et de simplifier le formalisme des G4.
- 1 Deciphering the Mechanism of Inhibition of SERCA1a by Sarcolipin Using Molecular Simulations Barbot, T., Beswick, V.*; Montigny, C., Quiniou, E., Jamin, N., Mouawad, L.* Front. Mol. Biosci. 2021, 7, 606254
- 2 Flagellar microtubule doublet assembly in vitro reveals a regulatory role of tubulin C-terminal tails Schmidt-Cernohorska, M., Zhernov, I., Steib, E., Le Guennec, M., Achek, R., Borgers, S., Demurtas, D., Mouawad, L., Lansky, Z., Hamel, V.*, Guichard, P.* Science 2019, 363, 285-288
- 3 Photoactivatable Small-Molecule Inhibitors for Light-Controlled TAM Kinase Activity Le Bescont, J., Mouawad, L., Boddaert, T., Bombard, S., Piguel, S.* ChemPhotoChem 2021, 5, 989-994
- 4 Optimization of G-Quadruplex Ligands through a SAR Study Combining Parallel Synthesis and Screening of Cationic Bis(acylhydrazones) Reznichenko, O., Leclercq, D., Franco Pinto, J., Mouawad, L., Gabelica, V., Granzhan, A. Chem Eur J 2023, e202202427
- 5 ASC-G4, an algorithm to calculate advanced structural characteristics of G-quadruplexes Farag, M., Messaoudi, C., Mouawad, L.* Nucleic Acids Research 2023, 51, 2087-2107