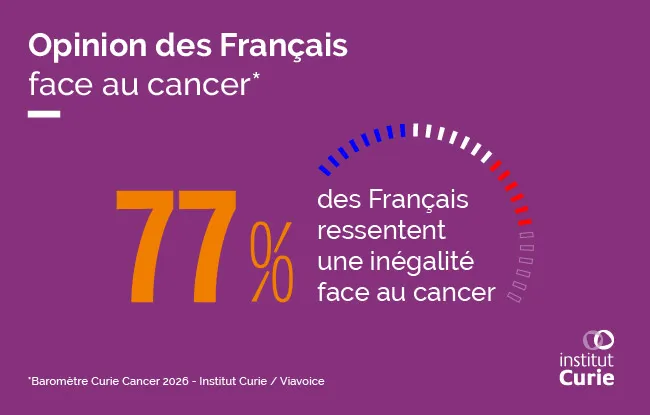- Accueil >
- Les actualités de l'Institut Curie >
- Octobre Rose 2025 : Les biomarqueurs circulants, un tournant dans la prise en charge des femmes atteintes de cancer du sein
A l’occasion d’Octobre rose, l’Institut Curie fait le point sur les recherches et les innovations en matière de biomarqueurs circulants (cellules, ADN, ARN, vésicules extracellulaires) et de biopsies liquides, avec pour objectif : mieux diagnostiquer et adapter les traitements pour une prise en charge toujours plus précise et personnalisée de chaque patiente à tous les stades de la maladie.
1er centre européen de lutte contre les cancers du sein, fondateur de l’IHU Institut des Cancers des Femmes avec l’Université PSL et l’Inserm pour mieux comprendre, prévenir et traiter les cancers des femmes, l’Institut Curie prend en charge plus de 7 000 femmes atteintes d’un cancer du sein, dont plus de 3 000 nouvelles patientes chaque année.
Avec plus de 60 000 nouveaux cas chaque année en France, le cancer du sein reste le premier cancer féminin et la première cause de mortalité par cancer chez les femmes, avec 12 000 décès par an.
Les enjeux sont multiples : mieux comprendre, mieux diagnostiquer, suivre et traiter les patientes, avec le moins de toxicités possibles, en mettant en œuvre des stratégies toujours plus précises et plus personnalisées.
Pr Steven Le Gouill directeur de l’Ensemble hospitalier de l’Institut Curie
La biopsie liquide marque un tournant déterminant en oncologie : cette technique ouvre la voie à la détection dans le sang de la présence ou de l’évolution d’un cancer grâce aux biomarqueurs circulants, qui peuvent être de l’ADN tumoral, des cellules tumorales, des vésicules extracellulaires ou encore des ARN.

« Cette avancée majeure est le fruit de travaux de recherche fondamentale menés depuis plus de 20 ans, auxquels les chercheurs de l’Institut Curie ont fortement contribué, en collaboration avec leurs collègues médecins, précise le Dr Claire Rougeulle, directrice du Centre de recherche de l’Institut Curie. Nos équipes de recherche s’attachent désormais à trouver des indices moléculaires encore plus précis et à mettre au point de nouvelles techniques pour améliorer leur détection, en faisant appel notamment à l’intelligence artificielle. »
 Cette méthode innovante et très prometteuse de détection de biomarqueurs circulants dans le sang ouvre la voie à de nombreuses applications :
Cette méthode innovante et très prometteuse de détection de biomarqueurs circulants dans le sang ouvre la voie à de nombreuses applications :
- Pour le dépistage avec l’idée que la biopsie liquide pourrait un jour compléter les examens radiologiques actuels.
- Pour le diagnostic et le pronostic car le type de matériel circulant et sa quantité informent sur l’ampleur et la progression de la maladie.
- Pour suivre l’efficacité et la résistance aux traitements : en cours de traitement, l’évolution de l’ADN tumoral circulant renseigne sur l’efficacité de l’approche thérapeutique, tandis qu’une fois les soins terminés, la détection d’ADN tumoral circulant peut révéler une maladie résiduelle et donc un risque de récidive.
Nettement moins invasive qu’une biopsie classique, cette technique peut être répétée plus souvent sans altérer la qualité de vie de la patiente.
 « Les biomarqueurs circulants vont maintenant être
« Les biomarqueurs circulants vont maintenant être  au cœur de la stratégie de la prise en charge et du suivi des cancers des femmes. Cette innovation vient en complément des analyses tissulaires classiques dont nous disposions jusqu’ici apportant un niveau de précision dans l’analyse du pronostic et du risque de rechute jamais égalée à ce jour. C’est une vraie révolution dans la conception des protocoles de traitement et de prise en charge de nos patientes, initiée à l’Institut Curie et en cours d’adoption partout dans le monde », se réjouit la Pre Anne Vincent-Salomon, pathologiste à l’Institut Curie, directrice de l’Institut des Cancers des Femmes.
au cœur de la stratégie de la prise en charge et du suivi des cancers des femmes. Cette innovation vient en complément des analyses tissulaires classiques dont nous disposions jusqu’ici apportant un niveau de précision dans l’analyse du pronostic et du risque de rechute jamais égalée à ce jour. C’est une vraie révolution dans la conception des protocoles de traitement et de prise en charge de nos patientes, initiée à l’Institut Curie et en cours d’adoption partout dans le monde », se réjouit la Pre Anne Vincent-Salomon, pathologiste à l’Institut Curie, directrice de l’Institut des Cancers des Femmes.
L’Institut Curie se mobilise fortement en recherche clinique pour que ces avancées se traduisent en bénéfice réel pour les femmes atteintes de cancer du sein.
 « Pour démontrer que l’identification des nouveaux biomarqueurs ou l’utilisation des nouvelles techniques d’analyse peuvent changer le devenir des patientes, l’Institut Curie a lancé de nombreux essais cliniques, indique le Pr François-Clément Bidard, oncologue médical à l’Institut Curie et directeur du Centre d’Investigation Clinique 1428 (Inserm/Institut Curie). Nous avons été les premiers à développer le concept d’interception des résistances au traitement grâce à l’ADN tumoral circulant, qui devrait permettre la mise sur le marché d’un nouveau médicament pour contrer la résistance à l’hormonothérapie, suite à l’essai clinique SERENA-6. Nous devrions aussi prochainement initier une nouvelle cohorte de l’essai ALCINA, qui permettra à 200 patientes à risque de rechute d’avoir accès à ces techniques novatrices de détection des rechutes, déjà remboursées aux Etats-Unis, mais pas encore prises en charge en France ».
« Pour démontrer que l’identification des nouveaux biomarqueurs ou l’utilisation des nouvelles techniques d’analyse peuvent changer le devenir des patientes, l’Institut Curie a lancé de nombreux essais cliniques, indique le Pr François-Clément Bidard, oncologue médical à l’Institut Curie et directeur du Centre d’Investigation Clinique 1428 (Inserm/Institut Curie). Nous avons été les premiers à développer le concept d’interception des résistances au traitement grâce à l’ADN tumoral circulant, qui devrait permettre la mise sur le marché d’un nouveau médicament pour contrer la résistance à l’hormonothérapie, suite à l’essai clinique SERENA-6. Nous devrions aussi prochainement initier une nouvelle cohorte de l’essai ALCINA, qui permettra à 200 patientes à risque de rechute d’avoir accès à ces techniques novatrices de détection des rechutes, déjà remboursées aux Etats-Unis, mais pas encore prises en charge en France ».

Autre exemple, dans les cancers du sein triple négatif, avec l’essai CUPCAKE qui va démarrer fin 2025 : « Cet essai très novateur a pour but la détection précoce de la récidive au niveau moléculaire pour la prendre en charge avant l’apparition des symptômes. C’est un enjeu majeur pour les femmes concernées », explique le Dr Fatima Mechta-Grigoriou, directrice de recherche Inserm, directrice de l’unité Chimie biologie des cancers (Inserm / CNRS / Institut Curie) à l’Institut Curie.
Témoignage - Ludivine Ernoult, 38 ans
« J’ai un parcours atypique et il y a 2 ans, ma vie a été sauvée grâce à la recherche. Je suis l’incarnation que les recherches sur l’ADN tumoral circulant sont bénéfiques pour les patients. Sans elles, je ne serai pas là aujourd’hui. »
 "En juillet 2021, j’ai été diagnostiquée d’un cancer du sein triple négatif. J’avais 34 ans, j’étais infirmière, avec 2 enfants en bas âge et une vie très rythmée. Dès lors, j’ai entamé un parcours de soin « classique » à l’Institut Curie à Saint-Cloud : chimio, chirurgie (un curage axillaire et une double mastectomie avec reconstruction immédiate), radiothérapie. Ma réponse au traitement a été complète et, en quelques mois, j’étais en rémission.
"En juillet 2021, j’ai été diagnostiquée d’un cancer du sein triple négatif. J’avais 34 ans, j’étais infirmière, avec 2 enfants en bas âge et une vie très rythmée. Dès lors, j’ai entamé un parcours de soin « classique » à l’Institut Curie à Saint-Cloud : chimio, chirurgie (un curage axillaire et une double mastectomie avec reconstruction immédiate), radiothérapie. Ma réponse au traitement a été complète et, en quelques mois, j’étais en rémission.
A la rentrée 2023, le Pr Bidard qui me suivait à l’Institut Curie m’a proposé d’intégrer un essai clinique visant à détecter très précocement une rechute par la recherche d’ADN tumoral circulant. Avec cette appréhension de la récidive que je redoutais, j’ai démarré cet essai avec peu de contrainte puisqu’il s’agissait de faire une prise de sang tous les 3 mois. Les échantillons sanguins étaient envoyés pour analyse et les résultats revenaient au bout de 3 semaines - 1 mois. Or, ma 2e prise de sang a détecté de l’ADN tumoral circulant alors que l’examen clinique et l’imagerie mammaire n’avaient rien trouvé d’anormal. Deux jours après la réception des résultats de la prise de sang, j’ai passé un PET-scanner qui a « flashé », confirmant ainsi la rechute de mon cancer du sein, fort heureusement localisée à un ganglion isolé. J’ai eu une chance inouïe d’avoir eu un diagnostic précoce, ce qui m’a permis d’obtenir des soins adaptés tout de suite, alors que la rechute était encore guérissable. Je suis ensuite repartie dans un protocole de soins, lourd : chimiothérapie et immunothérapie, ré-opération au niveau du ganglion, radiothérapie et inhibiteur de PARP pendant un an – ce qui m’a permis d’être à nouveau en rémission et d’éviter la rechute généralisée qui serait survenue si je n’avais pas participé à l’essai clinique. Aujourd’hui, je n’ai plus de traitement.
Depuis 4 ans, je surfe sur les avancées médicales. Je ne peux qu’insister sur l’importance de la science, de la recherche, de la nécessité des progrès scientifiques. Mon parcours de soin est lourd mais malgré tout « chanceux »."
Les biomarqueurs circulants : un espoir sur tous les fronts
Une révolution est en marche : celle de la biopsie liquide, technique qui ouvre la voie à la détection de la présence ou de l’évolution d’un cancer dans le sang. L’Institut Curie se mobilise pour que ces avancées se traduisent en bénéfice réel pour la santé des patients, notamment pour les femmes atteintes de cancer du sein.
Une procédure moins invasive et informative
Etudiée par de nombreux laboratoires depuis environ une quinzaine d’années, la biopsie liquide consiste à rechercher des biomarqueurs du cancer dans le sang des patients. L’avantage ? Non seulement cette procédure est nettement moins invasive qu’une biopsie classique, donc elle peut être répétée plus souvent, mais en plus elle offre un bénéfice précieux, en particulier dans le cancer métastatique : celui de révéler l’hétérogénéité tumorale.
« En cas de métastases, il est impensable d’aller faire une biopsie dans chaque organe atteint pour identifier les éventuelles mutations de la tumeur ou de rebiopsier à chaque évolution de la maladie, explique le Dr Luc Cabel, oncologue médical à l’Institut Curie. Avec la biopsie liquide en revanche, elles peuvent toutes être retrouvées dans le plasma et il est possible d’identifier des mécanismes de résistance différents chez un même patient, à un instant précis comme au cours de l’évolution de la maladie. »
 Du dépistage au suivi post-traitement
Du dépistage au suivi post-traitement
Une nouvelle ère s’est ainsi ouverte dans la lutte contre le cancer. « Ces biomarqueurs peuvent être de l’ADN tumoral, des cellules tumorales, des vésicules extracellulaires ou encore des ARN, précise le Pr Jean-Yves Pierga, oncologue médical à l’Institut Curie. Et ils pourraient être ou sont déjà de précieux alliés contre les cancers du sein, à différentes étapes de la maladie. »
Pour le dépistage tout d’abord, avec l’idée que la biopsie liquide pourrait un jour compléter la mammographie de contrôle. Pour le diagnostic et le pronostic ensuite, car le type de matériel circulant et sa quantité peuvent informer sur l’agressivité ou la dissémination de la maladie. Pour le suivi du traitement et la prévision du risque de rechute enfin : l’évolution de la quantité d’ADN tumoral circulant renseigne sur l’efficacité de l’approche thérapeutique, tandis qu’une fois les soins terminés, la détection d’ADN tumoral circulant peut révéler une maladie résiduelle et donc un risque de récidive.
De la validité clinique à l’utilité clinique
Des tests permettent déjà l’utilisation de tels biomarqueurs, mais, bien qu’ils puissent prédire très efficacement la rechute métastatique, ils ne sont pas pour autant mis systématiquement à disposition des patientes en France.
« Les études n’ont pour le moment pas pu prouver que la détection de la rechute tumorale améliore la survie des patientes atteintes d’un cancer du sein métastatique par exemple, illustre le Dr Luc Cabel. Ce type de biomarqueurs pourrait tout de même avoir une utilité clinique, notamment pour la désescalade thérapeutique. A l’avenir, avec des tests très fiables, il serait possible d’envisager de réduire les traitements chez les patientes qui ne présentent pas de maladie résiduelle. »
Le Pr Jean-Yves Pierga abonde : « C’est là un défi majeur dans l’utilisation des biomarqueurs : il faut passer de la validité clinique à l’utilité clinique. En d’autres termes, réussir à tirer profit des biomarqueurs circulants pour améliorer réellement la qualité de vie ou la durée de survie des patientes. »
L’Institut Curie mise sur les essais cliniques
Or c’est justement l’expertise de l’Institut Curie. « Sous l’impulsion des Prs Jean-Yves Pierga et François-Clément Bidard, l’Institut a lancé de nombreux essais cliniques pour démontrer l’utilité clinique de ce type de biomarqueurs », rappelle le Dr Luc Cabel.
Avant l’essai PADA-1 par exemple, une modification de l’hormonothérapie dans le cancer du sein n’était pas envisagée tant qu’il n’y avait pas d’évolution constatée par imagerie. Depuis cette étude en revanche, il est démontré qu’une biopsie liquide permet de constater la survenue d’une résistance au traitement pour adapter ce dernier en conséquence, et donc retarder la progression tumorale et améliorer la qualité de vie des patientes.
« Au-delà des effets d’annonce, les biomarqueurs circulants portent réellement la promesse d’une personnalisation des traitements, estime le Pr François-Clément Bidard, oncologue médical et responsable du groupe de recherche translationnelle « Biomarqueurs tumoraux circulants » à l’Institut Curie. Il reste des étapes à franchir en termes techniques et financiers, mais à terme, cet outil complémentaire va modifier la prise en charge des patientes. »