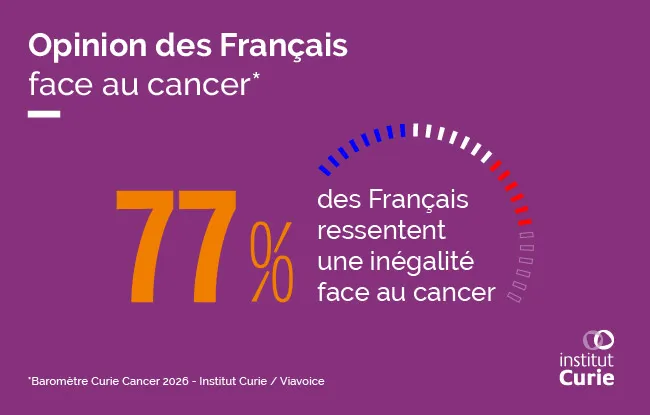- Accueil >
- Les actualités de l'Institut Curie >
- ESMO 2025 : l’Institut Curie à l’avant-garde de l’innovation contre les cancers
Du 17 au 21 octobre 2025 à Berlin (Allemagne), la communauté mondiale en cancérologie sera réunie pour le congrès de la Société européenne d’oncologie médicale (ESMO). Résultats d’essais cliniques dans les cancers du sein ou le mélanome uvéal, données de vie réelle, cancers d’origine inconnue… Pendant 5 jours, médecins et chercheurs de l’Institut Curie partageront leurs résultats prometteurs, leurs innovations et leurs expertises pour accélérer les découvertes en oncologie aux bénéfices des patients.
Les cancers féminins
Cancer du sein
Vers des traitements moins toxiques pour les femmes atteintes de cancers du sein hormonodépendant
Peut-on adapter les traitements de certains cancers du sein et remplacer la chimiothérapie par des traitements moins toxiques ? C’est ce qu’évalue l’essai clinique RIBOLARIS promu par Solti en Espagne et coordonné par Unicancer dont les résultats préliminaires seront présentés en session orale par le Pr Paul Cottu, oncologue médical à l’Institut Curie le 17 octobre 2025.
Risk of Recurrence (ROR) After Neoadjuvant Ribociclib Plus ET in Clinically High-Risk ER+/HER2− BC: Preliminary Analysis of the SOLTI RIBOLARIS Trial - Session orale “Proffered paper - Breast cancer, early stage”: 17 octobre 2025 – Pr Paul Cottu
ESME : les chiffres actualisés pour les cancers du sein métastatiques issus de la plus grande base de données de vie réelle en France
Issues du programme ESME (Epidémio-Stratégie Médico-Economique, base UNICANCER), les données actualisées sur la survie globale des patientes atteintes de cancers du sein métastatiques (HER2+, hormonodépendants et triple négatif) seront présentées au congrès de l’ESMO.
Obtenues auprès de plus de 33 000 patientes, sans équivalent dans le monde en termes de chiffres, les données à jour montrent que la survie globale augmente régulièrement, notamment chez les patientes atteintes de cancers du sein HER2+ et hormonodépendants, probablement du fait de l’utilisation de nouvelles thérapies, comme les inhibiteurs CDK4/6. L’impact des innovations thérapeutiques n’a eu qu’un effet limité sur les chiffres de survie globale chez les patientes atteintes d’un cancer du sein triple négatif, soulignant l’importance de poursuivre les recherches pour le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques dans ce cancer.
Evolution of overall survival across subtypes in 33.044 patients with metastatic breast cancer in the 2025 update of the national cohort - Poster session Metastatic breast cancer - 20 octobre 2025 – Pr Paul Cottu
La neurofibromatose de type 1, facteur d’agressivité des cancers du sein
Affectant environ 1 personne sur 3 000, la neurofibromatose de type 1 (NF1) est un syndrome héréditaire lié au gène NF1 (codant pour une protéine appelée neurofibromine qui contribue à réguler la croissance cellulaire). Les patientes présentant ce syndrome et atteintes d’un cancer du sein ont montré des caractéristiques agressives, posant l’hypothèse que la NF1 influence le développement de la maladie tumorale. Afin de répondre à cette question, des travaux menés à l’Institut Curie ont comparé des cohortes de patientes atteintes d’un cancer du sein, avec ou sans NF1.
Les résultats obtenus auprès d’environ 400 patientes révèlent que le cancer du sein chez des femmes atteintes de NF1 présente des caractéristiques plus agressives, associées à un plus haut risque de cancer du sein controlatéral, suggérant une prise en compte de ce facteur dans la surveillance de ses femmes. Les données montrent par ailleurs que, malgré ses facteurs d’agressivité, aucun n’impact sur la survie globale n’est retrouvé, probablement grâce à l’efficacité des traitements actuels.
Breast cancers (BC) in a series of 140 women affected with neurofibromatosis 1 (NF1): clinical and pathological characteristics, prognosis - Poster session Breast cancer, early stage - lundi 20 octobre – Dr Sophie Frank
Cancers gynécologies
Près de 18 000 femmes sont touchées par les cancers gynécologiques chaque année en France. Ces cancers regroupent des pathologies complexes et variées nécessitant des prises en charge coordonnées et personnalisées. Au cœur des préoccupations de l'Institut Curie et de son IHU Institut des Cancers des Femmes (co-fondé avec l’université PSL et l’Inserm), les équipes de recherche et de soin s'unissent pour améliorer le diagnostic, renforcer la prévention, garantir une prise en charge optimale à toutes les phases de la maladie adaptée à chaque patiente.
Cancer de l’endomètre métastatique : analyse des données d’efficacité et de tolérance de la combinaison d’immunothérapie et d’une thérapie ciblée au sein d’une cohorte française multicentrique
Le cancer de l’endomètre est le cancer gynécologique le plus fréquent en France, le quatrième cancer féminin, avec 8 000 cas annuels estimés1 . Les résultats positifs de l’étude de phase 3 Keynote-775 a constitué un tournant dans la prise en charge des cancers de l’endomètre avancés en échec d’une chimiothérapie par carboplatine grâce au bénéfice en survie globale conféré par l’association d’une immunothérapie (pembrolizumab) et d’une thérapie ciblée (lenvatinib). L’application de cette stratégie thérapeutique dans une population « vie réelle » représente un enjeu clinique. Afin de mieux comprendre l’effet de ce traitement, notamment sa tolérance parmi des populations plus âgées et présentant des maladies aux profils évolutifs différents, LARENA, étude nationale co-promue par l’Institut Curie et ARCAGY-GINECO analyse les données de survie sans progression, survie globale et la sécurité du traitement.
Les résultats mettent en évidence que chez les 351 patientes de la cohorte, une individualisation de la dose d’initiation du lenvatinib permet une moindre toxicité, sans altérer l’efficacité dans tous les sous-groupes de patientes.
Cancers de l’ovaire : l’efficacité de la chirurgie comme traitement standard
Parmi les cancers gynécologiques, le cancer de l’ovaire touche plus de 5 000 femmes en France2 chaque année, le plus souvent autour de 65 ans. Dans 90 % des cas, ce sont des cancers épithéliaux de l’ovaire, dont les deux tiers sont des carcinomes séreux de haut grade.
La chirurgie cytoréductrice au niveau de la cavité abdominale, qui vise à retirer les tissus tumoraux, est un traitement central dans les cancers de l’ovaire avancé. Le positionnement d’une telle chirurgie dans les cancers de l’ovaire de stade IV reste néanmoins sous-exploré. A partir des données du programme ESME (Epidemio-Stratégie Médico-Economique, base UNICANCER), les équipes de l’Institut Curie ont identifié les facteurs influençant l’éligibilité à la chirurgie dans les carcinomes séreux de stade IV, ainsi que son impact sur la survie globale, chez plus de 6 000 patientes.
Les résultats montrent que les patientes opérées ont une survie sans progression et globale significativement meilleure que les patientes non opérées. Parmi les patientes opérées, les critères qui gouvernent une meilleure survie globale sont le nombre de sites métastatiques (et donc la charge tumorale), l’état général et le caractère macroscopiquement complet de la chirurgie. Ces données confortent la place de la chirurgie dans le cancer de l’ovaire de stade IV.
Efficacy and Tolerability of Pembrolizumab–Lenvatinib in Metastatic Endometrial Cancer: Results from the French Multicenter Early Access Program (LARENA Study) et Role of surgery in stage IV High-Grade Serous Ovarian Carcinoma: A French Population-Based Multicenter Study - Session poster Gynaecological cancer - 18 octobre 2025 – Dr Diana Bello Roufai
Mélanome uvéal métastatique
L’Institut Curie est centre expert national pour la prise en charge des mélanomes uvéaux qui sont les tumeurs malignes de l’œil les plus courantes chez l’adulte et pour lesquelles les métastases (souvent hépatiques) sont fréquentes.
Le traitement standard dans ce cas est une immunothérapie par tebentafusp, un anticorps bispécifique (capable de rediriger les lymphocytes T CD3+ du patient contre la glycoprotéine gp100 exprimée par les cellules de la peau et les cellules tumorales de mélanome). Le tebentafusp peut être utilisé chez environ 45% des patients (ceux présentant une forme spécifique HLA (sérotype HLA*02:01)3 ), nécessaire pour déclencher cette immunité anti-mélanome).
D’autres immunothérapies ont une efficacité moindre, illustrant le besoin d’identifier de nouvelles stratégies de traitement pour les patients atteints de mélanomes uvéaux métastatiques.
Une nouvelle combinaison de traitement prometteuse
Dans ce contexte, l’essai clinique de phase 2 PLUME vise à évaluer l’efficacité et la tolérance de l’association d’une immunothérapie utilisant des anticorps anti-PD-1 avec un traitement ciblé. Les premiers résultats de cette étude PLUME seront présentés par le Dr Manuel Rodrigues, investigateur principal de l’essai clinique PLUME, et médecin-chercheur à l’Institut Curie en mini-oral à l’ESMO le 18 octobre prochain.
Communiqué de presse à venir le 18 octobre
PLUME : a single-arm phase II trial of pembrolizumab (pembro) plus lenvatinib (lenva) in patients (pts) with metastatic uveal melanoma (mUM) – Mini oral session: Melanoma and other skin tumours– 18 octobre - Dr Manuel Rodrigues
Mélanome uvéal : des profils génomiques pour mieux prédire l’efficacité de l’immunothérapie par tebentafusp
Une étude rétrospective menée à l’Institut Curie et présentée au congrès de l’ESMO 2025 a analysé 168 patients atteints de mélanome uvéal métastatique traités par tebentafusp entre 2018 et 2024 (patients avec une forme spécifique HLA).
Les résultats montrent une efficacité comparable à celle observée dans l’essai d'enregistrement de ce traitement, qui a été bien toléré. Cette étude révèle que certains profils génomiques (perte de BAP1, monosomie 3, mutations SF3B1/EIF1AX) semblent influencer le pronostic et pourraient aider à mieux prédire la réponse au traitement.
Clinical and molecular outcomes of tebentafusp in metastatic uveal melanoma (MUM): A retrospective cohort of 168 patients. Poster session Melanoma and other skin tumours – 20 octobre – Dr Raphaël Sanchez
Early together : une étude française pour évaluer les bénéfices des soins de support dans la prise en charge des mélanomes uvéaux métastatiques
Lorsque le mélanome uvéal devient métastatique, les symptômes surviennent souvent très tard, très rapidement, rendant difficile la mise en place des soins de support. Une étude multicentrique de phase 3 « Early Together », coordonnée par le Dr Sophie Piperno-Neumann, oncologue à l’Institut Curie, évalue l’introduction précoce des soins palliatifs dès le début du traitement oncologique chez les patients atteints de mélanome uvéal métastatique, en matière de besoins d’information et soins de support.
De juillet 2020 à janvier 2024, 162 patients ont été randomisés dans les deux centres participants (Paris et Nice) : les soins palliatifs ont été introduits conformément aux recommandations pour un groupe. Dans l’autre groupe, les consultations de soins palliatifs ont débuté à l'annonce des métastases par l'oncologue et se sont poursuivies pendant un an.
Les résultats présentés à l’ESMO montrent l’absence de différence significative entre les groupes ; cependant d'autres analyses sont en cours.
Early together: Randomized phase 3 trial of early palliative care (EPC) integration in metastatic uveal melanoma (MUM) – session poster Palliative care – 19 octobre 2025 – Dr Sophie Piperno-Neumann
Cancers de primitif inconnu : la coordination nationale améliore la prise en charge des patients et permet de collecter des données uniques pour la recherche
Les « cancers d’origine inconnue » ou « de primitif inconnu » (CUP) sont des cancers découverts par la présence de métastases, c’est-à-dire lorsque la maladie s’est propagée à différents tissus, sans qu’on ait pu identifier le premier organe touché. Ils représentent entre 2 et 3 % des cas de cancers (soit environ 7 000 patients par an en France4) et sont particulièrement difficiles à soigner.
En France, une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) dédiée aux CUP regroupe différentes spécialités médicales pour orienter le traitement pour chaque patient. Cette RCP a été créée en 2020 et est coordonnée au niveau national par l’Institut Curie.
L’analyse des données de 246 patients ayant bénéficié de l’expertise de cette RCP nationale entre 2020 et 2023 montre que l’intégration des résultats cliniques, pathologiques, moléculaires est possible en vie réelle dans ces maladies de très mauvais pronostic. Elle a permis l’identification du tissu d’origine supposé dans 70% des cas, permettant d’orienter le traitement, grâce notamment à des thérapies ciblées sur le tissu d’origine. La survie globale médiane des patients ayant bénéficié d’un traitement orienté était de 18,6 mois, contre 11 mois pour les patients ayant reçu un traitement empirique, selon les normes de traitement internationales, confortant le bénéfice de RCP et de centres de références pour la prise en charge des cancers de primitif inconnu.
Dans une autre étude sur les CUP, les médecins se sont intéressés aux métastases cérébrales. Environ 20% des patients atteints de cancers métastatiques ont des métastases au cerveau, dont 15% sont des cancers de primitif inconnu. Afin de mieux décrire les paramètres cliniques et épidémiologiques de ces métastases de primitif inconnu, une étude rétrospective a été menée sur les données cliniques, pathologiques, moléculaires et de survie de 62 patients (19 centres français), collectées dans le cadre de la RCP nationale. Leur analyse montre une hétérogénéité, notamment dans les tissus d’origine supposée, avec une surreprésentation des tumeurs d’origine digestive. Ces données seront complétées par des analyses moléculaires poussées (génomiques, transcriptomiques, épigénétiques) afin d’améliorer la classification des tumeurs, cruciale pour adapter les traitements.
Par ailleurs, les résultats d’une étude rétrospective menée auprès de 25 patients atteints de cancers de primitif inconnu (dont les données ont été discutées dans le cadre de la RCP nationale) seront également présentés au congrès. Elle vise à étayer les données sur les CUP avec suspicion d’une origine dans le sein, données restant limitées aujourd’hui.
Ces travaux révèlent une sur-représentation de patients hommes parmi les personnes inclues dans l’étude, de même qu’une sur-représentation des cas de cancers du sein triple négatif. Grâce aux analyses menées par la RCP, ces patients ont pu recevoir des thérapies ciblées ayant eu un effet bénéfique sur la survie globale, plus élevée que celle habituellement rapportée des patients atteints de CUP.
French national multidisciplinary tumor board improves the management and survival of patients with cancer of unknown primary - Session poster Tumour biology and pathology - 20 octobre 2025 – Célia Dupain(1ère auteure) et Dr Sarah Watson (dernier auteur)
Clinical, pathological and molecular characteristics of brain metastases from cancer of unknown primary (BM-CUP) : a multicenter French retrospective cohort - Session poster Biomarkers & translational research (agnostic) - 20 octobre 2025 – Dr Sarah Watson
Clinical and biological characteristics of a French cohort of cancer of unknown primary with suspected breast origin - Session poster Biomarkers & translational research (agnostic) - 20 octobre 2025– Dr Sarah Watson(1ère auteure) et Pr Christophe Le Tourneau (dernier auteur)
Médecine oncologique : comment optimiser les soins ? Quelle perception de l’impact environnemental ?
Optimisation de la prise en charge avec les chimiothérapies
Des travaux menés en collaboration avec l’Institut Curie se sont intéressés aux questions liées à l’administration des chimiothérapies de la famille des sels de platine, traitements de référence dans la prise en charge des patients atteints de cancer. Une première étude, réalisée en collaboration avec l’hôpital Henri Mondor, a porté sur la dose d’un médicament de chimiothérapie (le carboplatine) habituellement calculée en fonction d’une estimation de la fonction rénale selon une méthode qui peut être faussée chez certains patients. L’équipe de recherche propose l’utilisation d’une nouvelle formule qui permettrait de mieux estimer la fonction rénale des patients, et ainsi mieux personnaliser la dose de carboplatine, pour éviter une sur-toxicité.
Par ailleurs, concernant la chimiothérapie à base de cisplatine, il n’existe pas de consensus quant au protocole d’hydratation à prescrire, afin d’éviter une toxicité rénale de la molécule. Les résultats d’une enquête exploratoire, basée sur l’envoi d’un questionnaire aux professionnels de santé, révèlent en effet qu’il existe une hétérogénéité dans les procédures d’hydratation réalisées en France, illustrant le besoin de recommandation nationales et internationales pour une meilleure prise en charge des patients.
Quel est l’impact environnemental des soins en oncologie ?
Comment les professionnels de santé perçoivent-ils l’impact environnemental de l’oncologie ? L’analyse des résultats d’un questionnaire portant sur l’oncologie et l’écologie montre qu’une grande majorité des professionnels de santé en oncologie interrogés estiment que leur spécialité a un effet plus néfaste sur l’environnement que d’autres, en lien notamment avec l’usage de biothérapies, chimiothérapies et radiothérapies, et qu’il s’agit d’un élément non suffisamment pris en compte dans l’organisation et la conception des soins à l’heure actuelle.
Carboplatin dose calculation based on renal function assessment using the MMB-eGFR formula: a proof-of-concept study - Session poster Supportive care - ePoster - Dre Elise Dominjon (speaker), Dr Matthieu Delaye (dernier auteur)
Hydration practices during cisplatin administration: a national multicenter survey - Session poster Supportive care - 19 octobre 2025 – Dr Paul Matte (speaker), Dr Matthieu Delaye (dernier auteur)
Perception of the environmental impact of oncology care, a survey of French and Belgian caregivers - Session poster Policy - 19 octobre 2025 – Dr Paul Matte (speaker), Dr Matthieu Delaye (dernier auteur)
Cancers des voies biliaires et de la vessie
IMMUNOBIL : premiers résultats de l’étude évaluant une combinaison d’immunothérapies chez les patients atteints d’un cancer des voies biliaires
Les cancers des voies biliaires sont des tumeurs rares, touchant autour de 3 000 à 4 000 personnes par an en France5, bien souvent de mauvais pronostic. Jusqu’à récemment, le standard de traitement pour les cancers des voies biliaires en première ligne était une combinaison de chimiothérapies, avant d’être remplacé par une immunothérapie, combinée à une chimiothérapie.
L’essai clinique de phase 2 IMMUNOBIL, promu par le GERCOR, et dont l’investigatrice principale est la Pre Cindy Neuzillet, oncologue médicale à l’Institut Curie, visait à évaluer l’efficacité d’une combinaison d’immunothérapies utilisant des anticorps anti-PD-L1 (durvalumab) et anti-CTLA-4 (tremelimumab) chez 212 patients après échec d’une chimiothérapie. Le critère d’évaluation principal sur la survie globale à 6 mois n’a pas été atteint. « Les résultats relatifs à l’analyse de la survie des patients en fonction de la réponse tumorale peuvent cependant être mis en avant. Nous avons observé que les patients dont la tumeur était stable ou en diminution lors de la première évaluation, avaient une survie très prolongée pour une population en deuxième ligne de traitement, avec 18 mois de survie globale médiane. Nous avons également montré que le score de PD-L1 CPS6 (combined positive score) d’une valeur supérieure à cinq était associé à une survie globale plus longue, ce qui n’avait pas été démontré jusqu’ici dans ce type de cancer.
Cette étude permet donc de montrer qu’il y a un sous-groupe de patients qui bénéficie davantage de l’immunothérapie, et que le score PD-L1 CPS pourrait être un des marqueurs permettant de les identifier, mais qu’il n’est pas suffisant » précise le Dr Matthieu Delaye, oncologue médical à l’Institut Curie.
A cette étude, est adossé un programme ancillaire : IMMUNOBIL-SIGN (financé par le Programme de recherche translationnelle en cancérologie, PRT-K) afin d’identifier les facteurs impliqués dans la réponse aux immunothérapies dans les cancers des voies biliaires. « Les résultats de ce programme pourraient amener à mieux comprendre les bénéfices de l’immunothérapie, désormais utilisée en première ligne dans les cancers des voies biliaires, » conclut le Dr Matthieu Delaye.
Durvalumab (D) plus tremelimumab (T) in advanced biliary tract carcinoma (BTC) patients (Pts) after failure of platinum-based chemotherapy (CTx): Final results of the IMMUNOBIL GERCOR D18-1 PRODIGE-57 phase II trial - Session mini-oral GI tumours, upper digestive - 20 octobre 2025 – Dr Matthieu Delaye (speaker), Pre Cindy Neuzillet (dernier auteur)
Un nouvel outil d’IA pour mieux caractériser les cancers de la vessie
Il existe de nombreux sous-types de tumeur de la vessie infiltrant le muscle, dont le pronostic et la réponse au traitement sont variables.
Afin de pouvoir les identifier rapidement, une étude à laquelle les équipes de l’Institut Curie ont participé, a permis de développer un modèle d’IA, capable de prédire l’expression de gènes associés à différents sous-types du cancer. Cet outil a été conçu à partir de coupes histologiques de 297 patients inclus dans l’essai clinique VESPER7.
Les résultats montrent que l’IA réussit à prédire les sous-types de cancer à partir des échantillons et pourrait donc permettre la classification des patients en clinique, sans avoir recours au séquençage.
Artificial intelligence predicts molecular subtypes and outcomes in muscle-invasive bladder cancer from whole slide images - Session poster Urothelial cancer - 18 octobre 2025 – Dr Alice Blondel
Médecine de précision : la quête des biomarqueurs, pour mieux suivre l’évolution des cancers
Cancers ORL : cinq nouvelles signatures pour suivre l’évolution de la maladie
Chez les patients atteints de cancer ORL avancé ou métastatique, l’efficacité de l’immunothérapie (nivolumab) reste limitée, avec seulement 20% de réponse. Afin de mieux suivre l’évolution de la maladie, il est crucial de mettre en évidence de nouveaux biomarqueurs.
L’analyse des données obtenues auprès de 176 patients ayant participé à différents essais cliniques a permis aux équipes de l’Institut Curie d’identifier cinq signatures transcriptomiques en lien avec le système immunitaire, associées avec la survie sans progression de la tumeur et la survie globale des patients.
Par ailleurs, une étude de phase 2 présentée à l’ESMO, avait pour objectif d’évaluer l’efficacité d’une combinaison d’inhibiteurs de points de contrôles immunitaires PD-1 avec une immunothérapie sur l’évolution de la maladie. Les résultats négatifs montrent ainsi que la survie sans progression médiane n’a pas été affectée par les traitements supplémentaires, même si les taux de réponse sont plus élevés.
Validation of transcriptomic signatures associated with response or resistance to nivolumab in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) patients –Session poster Head and neck cancer, excluding thyroid - 20 octobre 2025 – Pr Christophe Le Tourneau (présentateur) et Pr Ivan Bièche (dernier auteur)
Retifanlimab (Anti–PD-1 mAb) Alone Or In Combination With Anti-LAG3 ± Anti-TIM3 mAbs In Previously Untreated, Recurrent And/Or Metastatic (R/M) PD-L1+ HNSCC: A Double-Blind Randomised Controlled Phase 2 Trial – Session mini-oral Head and neck cancer - 19 octobre 2025 – Pr Christophe Le Tourneau (dernier auteur)
Essai clinique PEVOsq : biomarqueurs épigénétiques identifiés chez les patients atteints de carcinomes à cellules squameuses
Dans les carcinomes à cellules squameuses (ORL, canal anal, vulve, pénis, col de l’utérus, poumon), les facteurs impliqués dans l’évolution tardive de la maladie sont peu connus, compliquant le suivi des patients.
Dans ce contexte, l’essai clinique PEVOsq, piloté par l’Institut Curie et promu par UNICANCER, mené chez des patients atteints de carcinomes à cellules squameuses, avait pour objectif d’évaluer l’efficacité d’une immunothérapie (pembrolizumab) associé à un épimédicament7 (vorinostat). A partir des données de 77 patients inclus dans l’étude PEVOsq, les médecins ont mis en évidence que l’état d’infiltration des cellules immunitaires mais aussi l’expression du gène HLA8 jouent un rôle prédictif dans la réponse à l’immunothérapie. Par ailleurs, les résultats de l’étude révèlent l’activation de signatures associées aux histones-désacétylases – groupe d’enzymes impliquées dans les mécanismes épigénétiques – chez les patients répondant positivement à l’immunothérapie, soutenant l’hypothèse du rôle de ces enzymes dans cette réponse.
Molecular biomarker analysis in the phase II basket PEVOSq trial testing pembrolizumab with vorinostat on late-stage squamous cell carcinoma supports HDAC inhibition as an immunotherapy enhancer- Session poster Biomarkers and translational research (agnostic) - 20 octobre 2025 – Pr Christophe Le Tourneau (co-dernier auteur) et Dr Nicolas Servant (co-dernier auteur)
L’épigénétique pour mieux suivre l’évolution des tumeurs
L’analyse de la méthylation de l’ADN est un outil prometteur pour le suivi de l’évolution des cancers, et un marqueur épigénétique est particulièrement intéressant : l’hypométhylation LINE-1. Des chercheurs de l’Institut Curie ont évalué la pertinence de l’analyse conjointe des altérations génétiques et du statut de méthylation LINE-1 dans l’ADN tumoral circulant (ADNtc9) de 32 patients atteints de cancers métastatiques, inclus dans l’essai SHIVA0210. Leurs résultats montrent que cette approche combinée renforce la sensibilité de détection des cancers dans l’ADNtc. Ces deux analyses corrèlent avec la réponse des patients aux traitements.
Cette étude confirme l’intérêt de l’hypométhylation LINE-1 comme biomarqueur de suivi dynamique et met en évidence la complémentarité des altérations génétiques et épigénétiques pour suivre l’évolution de la maladie.
Multimodal ctDNA profiling for disease monitoring in pancancer patients with advanced and/or metastatic disease included in the SHIVA02 trial - Session poster Biomarkers & translational research (agnostic) - 20 octobre 2025 – Dr Kenza Nedara (1ère auteure) et Dr Julien Masliah Planchon (dernier auteur)
De nouveaux biomarqueurs dans les cancers du poumon mutés HER2
Environ 3% des cancers du poumon non à petites cellules sont associés à une altération du récepteur HER2, connu notamment dans les cancers du sein et responsable de la prolifération des cellules tumorales. L’essai clinique SOHO-01, dont les premiers résultats prometteurs avaient été présentés à l’ASCO 2024, vise à évaluer la pertinence clinique de l’utilisation d’une thérapie ciblant HER2 (sevabertinib). Afin de mieux comprendre les effets de ce traitement, les équipes de l’Institut Curie ont réussi à identifier plusieurs biomarqueurs qui permettraient potentiellement de suivre l’évolution de la maladie chez les patients ; par exemple, la présence ou non d’un certain variant HER2 ou encore la dynamique d’élimination de l’ADN tumoral circulant.
Molecular factors and ctDNA dynamics associated with clinical outcomes in patients with HER2-mutant NSCLC treated with sevabertinib (BAY 2927088): exploratory analysis of the SOHO-01 study - Session poster NSCLC, metastatic - 18 octobre 2025 – Pr Nicolas Girard
En plus des présentations orales et de posters, les experts de l’Institut Curie participent aux educational sessions et symposium spéciaux
> Le Dr Etienne Brain, oncologue médical à l’Institut Curie, est invité à la session Factors to inform decision making beyong performance status et interviendra sur l’évaluation gériatrique.
> Le Dr Sophie Piperno-Neumann, oncologue médicale à l’Institut Curie, speaker invitée présentera lors de la session Emerging therapies in sarcomas., les développements thérapeutiques dans les sarcomes des tissus mous.
> Le Pr François-Clément Bidard, oncologue médical à l’Institut Curie et directeur du Centre d’investigation clinique 1428 (Inserm/Institut Curie), interviendra lors du symposium spécial : Next generation biomarkers and technologies of the future: what's next? sur le thème de la surveillance et interception des récidives.
> Le Dr Emanuela Romano, oncologue médicale, directrice médicale du Centre d'immunothérapie des cancers de l'Institut Curie, co-chair de l’ESMO Clinical Practice Guidelines faculty interviendra dans une session spéciale Challenge your expert dédiée aux macrophages associés au cancer et co-animera. Elle animera la 2e Session de CGPs dédiée au mangement de Lymphomes et de cancers du poumon non à petites cellules.
>Le Pr Christophe Le Tourneau, oncologue médical et chef du département des Essais cliniques précoces de l’Institut Curie animera la session Molecular and clinical advancements in salivary glands cancer and nasal/paranasal cavity cancers.
Source
[1] Incidence des principaux cancers en France métropolitaine en 2023 et tendances depuis 1990, BEH, Santé Publique France
[2] Source Institut National du Cancer
[3] Le gène HLA, pour Human Leukocyte Antigen, code pour une protéine exprimée à la surface des cellules immunitaires. Sorte de « passeport cellulaire », cette protéine sert ainsi à la reconnaissance des cellules de l’organisme entre elles.
[4] Rassy E, Pavlidis N. The currently declining incidence of cancer of unknown primary. Cancer Epidemiol 2019; 61: 139-141.
[5] “Cancer incidence and mortality trends in France over 1990-2018 for solid tumors: the sex gap is narrowing”, BMC cancer
[6] Le Score CPS pour Combined Positive Score, renseigne sur l’expression de PD-L1 dans les cellules tumorales et les cellules immunitaires et ainsi, aide à la décision thérapeutique.
[7] Impliquant des équipes françaises dont des médecins de l’Institut Curie, l’étude VESPER, dont les résultats ont été publiés en 2022, a changé les standards de traitement des cancers de la vessie. En effet, la combinaison de médicaments néoadjuvants (avant la chirurgie) testée dans l’étude (méthotrexate, vinblastine, doxorubicine et cisplatine à dose dense) s’est avérée plus efficace que le protocole utilisé jusqu’ici en routine (gemcitabine et cisplatine)
[8] Un épimédicament : molécule qui agit sur les mécanismes épigénétiques, à savoir des processus biologiques réversibles qui influent sur l’expression des gènes sans modifier la séquence d’ADN elle-même
[9] L'ADN circulant tumoral est constitué de fragment d’ADN provenant de la tumeur, libérés dans le sang, qui peuvent être analysés afin d'étudier l'évolution de la maladie, la réponse au traitement ou encore le risque de rechute.
[10] L’étude SHIVA, promue par l’Institut Curie, était un essai clinique de phase 2 randomisé preuve de concept comparant l’efficacité d’un traitement fondé sur le profil moléculaire de la tumeur à celle d’un traitement conventionnel chez des patients atteints d’un cancer métastatique réfractaire. L’essai SHIVA 02 visait à valider l'approche d’une médecine de précision dans le sous-groupe des patients présentant une altération moléculaire au niveau de la voie des MAP (mitogen-activated protein) kinases.